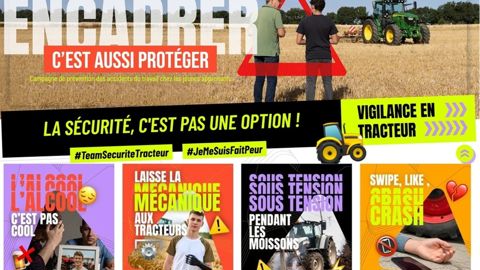Qu'est-ce que le PAI (point accueil installation) ?
> Une structure neutre, dans chaque département, animée par plusieurs organismes et avec des conseillers formés.
> La porte d'entrée unique pour les candidats à l'installation en agriculture.
→ Le conseil : à contacter dès qu'on projette de s'installer (toutes productions, phases de projet, âges, que l'on souhaite bénéficier des aides ou pas, que vous disposiez de foncier ou non...). C'est gratuit !
1ère prise de contact par téléphone puis, dans un 2e temps, un rendez-vous physique est organisé (mais en visio pour le moment en raison de la crise sanitaire du Covid-19).
Remarque : chaque PAI dispose d'un site web. Toutes les coordonnées des PAI de France métropolitaine et d'Outre-Mer sont à retrouver sur www.sinstallerenagriculture.fr
Étape 1 : se renseigner
> Sur les démarches à effectuer, les structures à contacter, les points à réfléchir, les aides financières...
Peu importe où les jeunes en sont : de la simple envie de devenir agriculteur à un projet déjà bien ficelé, pour un premier emploi ou une reconversion professionnelle. « Le PAI est là pour les accompagner et les guider dans leur réflexion mais ce sont eux qui prennent les décisions », appuie Lucille Faucon, animatrice JA 35 et conseillère PAI 35.
→ À noter : le PAI oriente, en fonction des besoins, vers les spécialistes du domaine concerné.
> Par ailleurs, sont généralement proposées :
- des journées collectives d'information (comme "Demain je m'installe" ou les "BCA" pour "bases de la création d'activité" qui sont gratuites),
- des portes-ouvertes ans des exploitations agricoles,
- des forums avec tous les partenaires,
- ou encore des cafés installation...
Le but : échanger avec d'autres porteurs de projet afin de faire avancer le sien, souligne Lucille Faucon.
> Quelles aides pour s'installer ?
- la DJA (dotation jeune agriculteur) pour les moins de 40 ans ayant la capacité professionnelle agricole (titulaires d'un Bac pro agricole ou d'un BPREA ou brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole) : en moyenne de 20 000-21 000 € en Bretagne,
- les soutiens régionaux (par exemple 6 000 € pour les porteurs de projet ayant entre 40 et 50 ans) et/ou des communautés de communes,
- les prêts d'honneur dans certaines productions,
- les avantages fiscaux et sociaux, comme des exonérations, liés au statut jeune agriculteur (ce dernier permet aussi la majoration du PCAEA, ou plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles pour les investissements neufs, et donne la priorité dans le Schéma directeur régional des exploitations agricoles ou SDREA).
! La plupart sont soumises à deux critères :
- la capacité professionnelle agricole (avoir le niveau bac agricole ou BPREA) comme pour la DJA, sachant que de nombreuses formations pour adulte y préparent,
- l'engagement dans le dispositif d'accompagnement à l'installation : pour la DJA, les avantages fiscaux et sociaux, les soutiens des communautés de communes, la majoration du PCAEA.
Étape 2 : compléter l'autodiagnostic
→ Objectif : clarifier son projet et identifier les compétences à développer.
Il s'agit d'un document à remplir avec le conseiller du PAI pour faire ressortir entre autres ses motivations, ses connaissances, ainsi que ses points forts et faibles comme ceux de son projet. D'ailleurs, à ce stade, on parle de "pré-projet".
« Cela permet, aux jeunes, de voir où ils en sont, s'ils sont prêts ou pas encore à se lancer dans le parcours à l'installation », développe Marine Le Porho, animatrice de Jeunes agriculteurs Bretagne et coordinatrice régionale des PAI bretons.
Être sûr de ses motivations et objectifs avant de sauter le pas !
« Lorsque c'est encore flou, on conseille de tester l'activité via une phase de salariat agricole ou des stages. Cela permet d'être sûr de ses envies et objectifs avant de sauter le pas, mais également de vérifier la cohérence et la faisabilité de son projet », complète Lucille Faucon.
Quels sont les besoins des jeunes ?
64 % ont finalisé leur projet et sont prêts à débuter le parcours à l'installation. 21 % recherchent une ferme ou du foncier. « C'est en effet compliqué de démarrer et de faire une étude de faisabilité quand on n'a pas le lieu », fait remarquer Marie-Isabelle Le Bars. 20 % désirent se former, « pour monter en compétence, acquérir une qualification et surtout obtenir la capacité professionnelle », à laquelle est conditionné l'accès aux aides. 11 % sont encore en cours de réflexion : « Ils appellent pour savoir si l'agriculture est faite pour eux. Ils ont envie d'échanger, d'avoir des avis et de réaliser des stages mais aucun choix n'est encore effectif », explique Marie-Isabelle. Dans le détail :
PPP : plan de professionnalisation personnalisé
CFE : centre de formalité des entreprises
MSA : Mutualité sociale agricole
Ces tendances, mises en évidence en Bretagne, sont valables dans d'autres départements.
Source de l'article : webinaire, organisé par la chambre d'agriculture de Bretagne, dans le cadre de la semaine régionale de l'installation et de la transmission, du 20 au 27/11/20 et de la Quinzaine de la transmission/reprise d'exploitations agricoles 2020 déployée à l'échelle nationale dans tout le réseau.