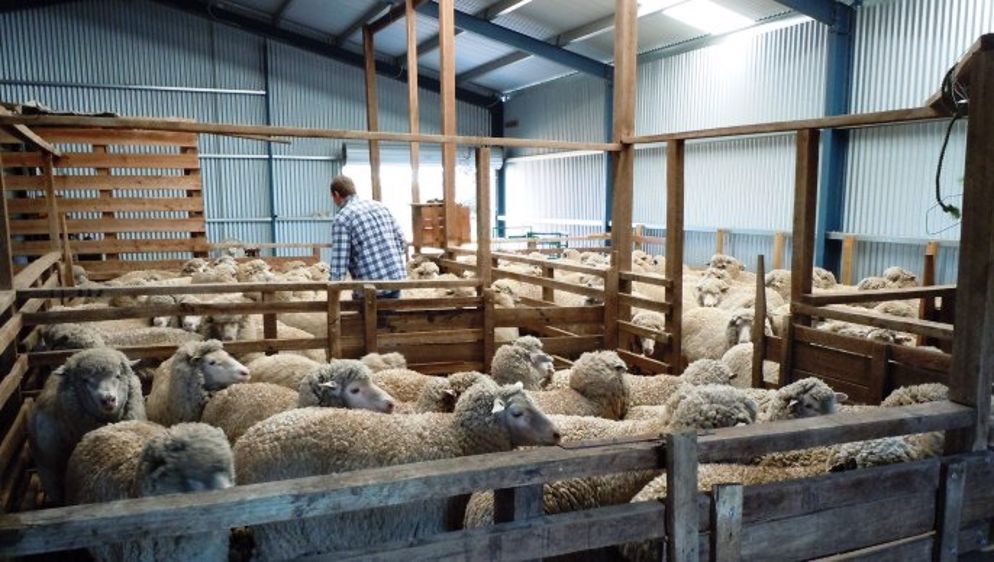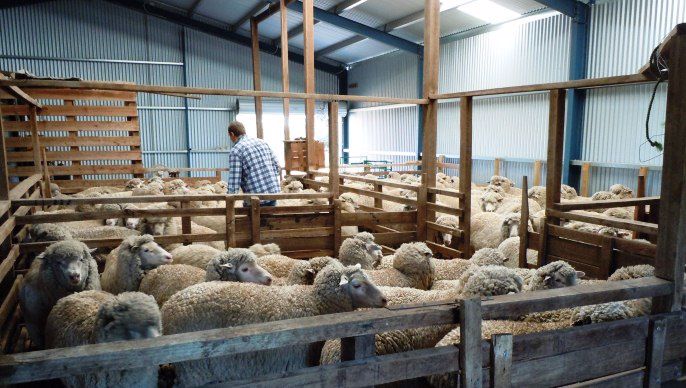
On déplore régulièrement depuis 2001 les difficultés rencontrées par les gouvernements qui négocient à l’Omc pour définir de manière unanime les modalités d’une régulation du commerce mondial. Pourtant, l’histoire des relations économiques internationales depuis la fin de la Seconde guerre mondiale montre que la régulation du commerce des marchandises s’était déjà heurtée à des blocages et à de multiples résistances.
Il était en effet question de créer, dans le cadre des Accords de Bretton Woods de 1944 et parallèlement au Fmi et à ce qui allait devenir la Banque Mondiale, une Organisation Internationale du Commerce (Oic). Ce fut un échec retentissant, les États-Unis ayant censuré le projet. Il fallut attendre 1947 pour voir émerger un Accord sur le commerce et les tarifs douaniers – le Gatt – lequel n’avait pas les attributs d’une organisation internationale. La succession des rounds de négociations a eu pour particularité de soustraire l’agriculture des négociations, à l’exception de quelques dimensions très techniques.
20 ans des accords de Marrakech
C’est lors de l’Uruguay round (1986-1994) que l’agriculture fut pour la première fois pleinement intégrée dans la négociation multilatérale. Les États-Unis, qui avaient reculé sur les marchés mondiaux, firent pression pour ouvrir des négociations agricoles au Gatt, stigmatisant au passage la concurrence européenne. Une fois les termes de l’accord fixés en décembre 2013, c’est en avril 1994 que le conflit agricole trouva son issue dans un accord commercial multilatéral. Il faut dire que l’Union européenne apporta une contribution décisive dans le déblocage des négociations avec la réforme de la Pac de mai 1992.
Célébrer le vingtième anniversaire des accords de Marrakech, c’est évoquer le déclenchement d’un long processus de libéralisation du commerce international de produits agricoles qui, pour certains, doit être approfondi. Il s’agissait bien d’une rupture importante par rapport à la période antérieure durant laquelle les dispositifs d’intervention sur les marchés agricoles empêchaient le libre-échange de se déployer conformément aux exigences d’une mondialisation vue comme vertueuse. Année après année, plusieurs secteurs agricoles ont été exposés à une pression concurrentielle de plus en plus élevée, à l’instar de la viande française de volailles. Les données chiffrées montrent bien que c’est à partir de 1996 que l’érosion de l’excédent commercial s’enclenche, passant de 1,4 milliard d’€ à 114 millions en 2012. Si l’ouverture commerciale y est pour quelque chose, il faut y voir également l’impact de la diminution drastique des restitutions aux exportations, que justement l’UE avait accepté d’opérer lors du cycle d’Uruguay.
L'OMC reste en panne
Depuis la fin des années 1990, on a pu assister à une lente mais non moins réelle montée en puissance des exportations des pays dit du groupe de Cairns (groupe dans lequel figurent des émergents aussi importants que le Brésil, l’Argentine et la Thaïlande), dont la part dans les exportations mondiales a augmenté, au détriment de celles des États-Unis et de l’UE. Avec de tels accords signés en 1994, c’est bien la hiérarchie des nations exportatrices de produits agricoles s’en est trouvée bouleversée.
Le problème pourra être retourné dans tous les sens, la généralisation de l’ouverture commerciale aux produits agricoles a bénéficié aux nations émergentes et peu voire pas du tout aux pays les plus pauvres. La doctrine du libre-échange avait pourtant nourri de grands espoirs dans cette libéralisation. L’Omc persévère pourtant dans cette logique de démantèlement de toutes formes de soutiens aux exportations. Sauf que l’évolution de l’économie mondiale a inscrit l’agriculture à l’agenda géoéconomique et que, dans certains pays, le recours au changement de parité monétaire constitue un atout non négligeable pour exporter, outil échappant totalement à l’Omc, car, précisément, la monnaie est du ressort de la souveraineté économique nationale. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour l’agriculture ? En dépit des timides avancées réalisées à Bali en décembre dernier, l’Omc reste en panne. D’où les stratégies de contournement déployées par certains États qui, à l’image des États-Unis et de l’UE, négocient entre eux. Le projet de partenariat transatlantique n’annonce pourtant rien de bon pour les agriculteurs français et, par surcroît, il s’agit d’une ambition bien opaque, au regard du peu d’informations sur le contenu du mandat du négociateur européen. »