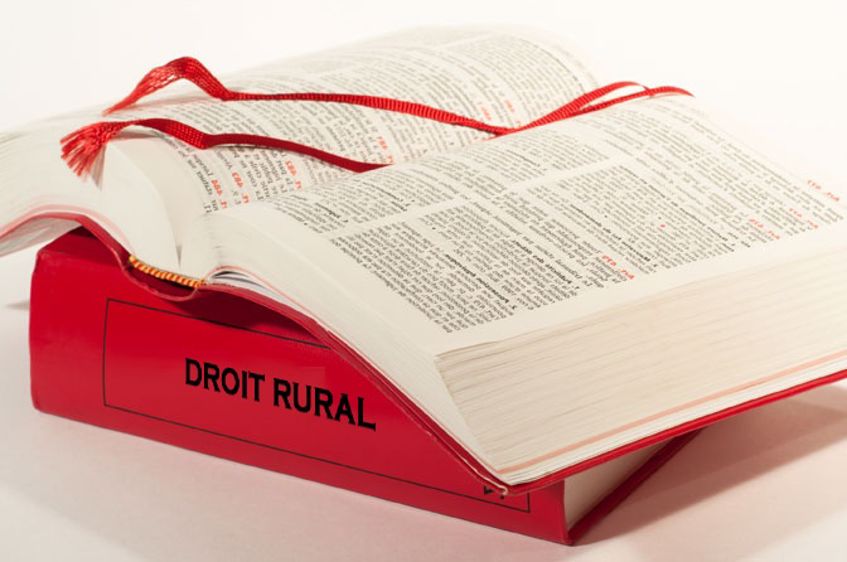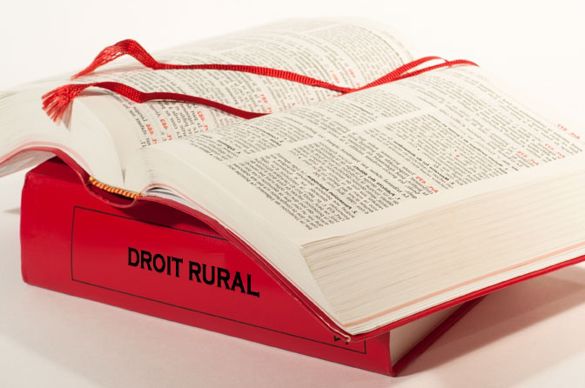
En effet, toute intervention sur les cours d’eau qui ne correspond pas à un entretien « régulier » au sens du Code de l’environnement doit faire l’objet d’une déclaration ou autorisation administrative préalable aux travaux. Le non-respect de cette procédure est passible d’amende et même de prison. Cette exigence n’existe pas à l’égard des travaux sur les fossés qui sont des déversoirs aménagés de main d’homme. Ces derniers peuvent être curés, recalibrés ou faire l’objet d’un busage et ceci sans autorisation administrative préalable. Sur bon nombre de territoires, les discussions enflent autour de la bonne appréciation de ce qu’est un fossé et de ce qu’est un cours d’eau et de la liberté ou pas d’entretenir ces espaces.
Le 21 novembre 2013, le Sénat a adopté en première lecture, une proposition de loi consacrée à la prévention des inondations et à la protection contre celles-ci. L’article 6 de la proposition de loi propose une définition légale des cours d’eau : « Art. L. 215-7-1. - Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Cette définition reprend la définition construite par la jurisprudence administrative et civile au fil du temps pour permettre la mise en œuvre de la police de l’eau. Cependant, ne figure pas la nouvelle approche jurisprudentielle qui se développe motivée par l’aspect biologique du milieu et qui sous-tend un élargissement difficile à contenir de la définition de cours d’eau non domaniaux. En cas d’adoption de la proposition de loi, les juges ne pourraient plus se servir des critères biologiques pour caractériser les cours d’eau non domaniaux. En revanche, rien n’indique dans l’écriture de cette définition comme dans les travaux parlementaires qu’elle modifierait la situation très complexe des cours d’eau qui dépendent tous de la police de l’eau et exceptionnellement des règles et des définitions propres à la conditionnalité, aux zones non traités, au classement des cours d’eau, à la couverture végétale permanente de l’article L. 211-14 du Code de l’environnement.
D'autres questions se posent
Enfin pour l’heure, il est difficile de voir concrètement en quoi la définition de la proposition de loi pourrait changer les débats qui existent sur le terrain pour apprécier ce qu’est un cours d’eau et ce qu’est un fossé. Et ce d’autant plus que l’on observe une volonté d’englober le curage des fossés dans les règles d’entretien « sans le même formalisme » (réponse à la question n°07060, Sénat, JO du 7 janvier 2010). Et ce alors que les fossés bouchés pour non entretien peuvent donner naissance à des zones humides d’où le basculement dans les nomenclatures de la réglementation « eau » propres à ces zones.
La proposition de loi, certes adoptée en première lecture par le Sénat, n’a pas encore été mise à l’ordre du jour à l’Assemblée nationale. Même adoptée, cette loi ne changera pas le fond du dossier qui reste au-delà des questionnements sur ce que sont les fossés et les cours d’eau, de savoir de quelle façon nous entretenons la nature pour lui concilier des activités agricoles. En outre, les questions de l’urbanisation, de l’imperméabilisation des espaces, de la mauvaise répartition des charges des inondations entre l’amont et l’aval, de la non gestion des terres agricoles inondables en tant que zones d’expansion des crues, de la mauvaise implantation des zones d’habitat, de l’absence d’articulation entre les devoirs des propriétaires riverains et des collectivités (surtout depuis les modifications introduites par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) restent posées. Et en attendant, les eaux montent dans les champs…