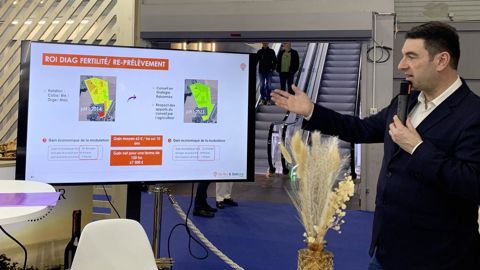C’est en fertilisation azotée que la modulation de dose intraparcellaire est le plus avancée. À partir d’une cartographie de la biomasse, effectuée le plus souvent par satellite, la machine ajuste automatiquement la dose d’azote à épandre selon la préconisation des besoins. Pour limiter la fatigue, mieux vaut s’équiper d’un appareil capable de gérer automatiquement la variation à partir des données transmises. Moduler les intrants manuellement à l’aide de la géolocalisation sur son smartphone reste cependant possible, en adaptant la dose ou en modifiant la vitesse d’avancement.
Certains s’aident aussi de capteurs de biomasse, mais la pratique se cantonne à une certaine élite. « La dose s’ajuste en temps réel selon les informations détectées par les capteurs installés sur le tracteur. La technique est précise, son seul inconvénient est qu’il est impossible de connaître à l’avance le volume d’engrais à épandre », glisse Florent Hendrycks, chef de produit épandeurs électroniques et digitaux chez Amazone.
Sur son exploitation de 270 ha installée à Graincourt-lès-Havrincourt (Pas-de-Calais), Hubert Caron a commencé à moduler manuellement il y a une dizaine d’années. « Grâce aux cartes, explique-t-il, je connaissais la dose prévisionnelle totale d’azote pour le blé, et j’avais des variations entre 70 et 130 unités selon les zones. J’appliquais cela à la louche avec mon distributeur d’engrais classique, c’était de l’agriculture de précision peu précise ! » Aujourd’hui, l’agriculteur bénéficie d’un semoir Kverneland multi dose connecté via l’Isobus.
Intérêt agronomique, pas économique
Si la technique est maîtrisée depuis des années en fertilisation azotée, reste à en mesurer les gains. « Modulation ne veut pas forcément dire économie de produit, prévient Vincent Gérard, responsable solutions électroniques et connectées chez Kuhn. Le but est plutôt d’optimiser les rendements ou de maximiser les taux de protéines. » La chambre d’agriculture des Hauts-de-France a mené des essais sur la culture du blé.
En modulant au stade "épi 1cm", le rendement augmente « mais le facteur gain reste limité », constate Aline Dupont, ingénieure agroéquipements connectés à la chambre d’agriculture de la Somme. Selon des résultats de 2015, cela varie seulement sur 2 q en moyenne. Quant au dernier apport, il influe davantage sur le taux de protéines. Mais « cela permet de réduire la pollution des nappes phréatiques », ajoute-t-elle. « Si vraiment vous voulez faire des économies d’engrais, mieux vaut opter pour la coupure de tronçon », propose David Guy, directeur général du groupe Burel (Sulky).
Pour l’engrais de fond, coûteux mais intéressant
Si la modulation intraparcellaire intéresse de plus en plus d’agriculteurs en fertilisation azotée (dans l’Aisne, par exemple, 12 à 15 % d’entre eux y ont recours), elle est, en revanche, beaucoup moins répandue au niveau des engrais de fond. Principal frein : le coût. Il faut compter 100 à 120 €/ha, zonage des parcelles et analyses chimiques inclus. Pour répartir la bonne quantité d’intrants selon le besoin, connaître le potentiel du sol s’avère nécessaire. Afin de le déterminer, plusieurs méthodes existent : conductivité, synthèse des données existantes sur l’exploitation... Quelle que soit l’option choisie, analyser chimiquement son sol demeure obligatoire (une analyse par hectare). Et cela coûte. Les premières méthodes permettent d’établir des cartes de teneur chimique pour différents éléments tels que le phosphore, le potassium, le magnésium, le pH, etc. À partir de ces données, des cartes de préconisation sont établies en fonction de la culture, du type de sol, de l’historique de fertilisation et des objectifs de rendement.
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le Gaec des Fabres, qui cultive des grandes cultures et du lavandin, tente ainsi de réduire la quantité d’engrais de fond utilisée. Il s’agit de la première exploitation agricole du secteur à avoir intégré la démarche Be Api fertilité, portée par l’union de coopératives InVivo. « On recueille des images aériennes depuis très longtemps et on redécoupe les parcelles en fonction de leur historique, détaille Denis Vernet, co-gérant du Gaec. Dans chacune des microparcelles de 0,8 ha, on fait ensuite des prélèvements, on module, cela nous permet d’économiser 20 à 30 % d’engrais selon les années. »

« Compte tenu de la flambée du prix des intrants, l’économie représente environ 80 €/ha aux cours actuels », évalue l’ingénieure agroéquipements connectés. En revanche, pas d’effet significatif sur les rendements. « Si l’on considère uniquement l’économie d’intrants, reprend-elle, alors le retour sur investissement se fait dès la cinquième année. On prend en compte les charges liées à la réalisation des cartes de préconisations et au matériel : guidage, déblocage de la licence... »
Au semis, la modulation manuelle demeure
Côté semis, de plus en plus d’agriculteurs modulent manuellement dans l’objectif d’avoir une population suffisante en sortie d’hiver. La modulation intraparcellaire automatique, elle, semble pour l’instant réservée à une poignée de précurseurs. La technique reste en effet complexe et onéreuse au démarrage.
Il faut cartographier le potentiel des sols, à l’aide de la conductivité ou via la topographie, de la géologie et des images satellite sur sol nu. Ensuite, il faut bénéficier d’un semoir équipé d’une régulation électronique, et que le terminal accepte la carte. « Beaucoup d’agriculteurs s’interrogent sur les trémies, sur la possibilité de gérer semences, engrais et micro-granulés en un seul passage. Jamais nous ne sommes interpellés sur des questions liées à la modulation de dose », témoigne Florent Hugon, responsable produits semis chez Horsch. « Le service coûte cher, pointe Jean-Charles Lescieux, chef produit épandeur d’engrais Bogballe. En outre, il est indispensable de posséder un semoir adapté, qui coûte cher également et qui n’est pas renouvelé aussi souvent qu’un épandeur d’engrais. » Le retour sur investissement se révèle difficile à chiffrer. D’après les résultats des essais conduits par la chambre d’agriculture des Hauts-de-France, « le gain le plus important que l’on obtient se monte à 2 q/ha et dans le pire des cas, ça ne fait aucune différence », résume Aline Dupont, spécialiste des équipements connectés.
Si l’intérêt économique est plutôt limité, la modulation de la dose de semis a du sens agronomiquement, surtout les années sèches, estime néanmoins Aline Dupont. On adapte le peuplement de la culture en fonction du potentiel du sol et de sa capacité de rétention d’eau.
Avec les fongicides, peu de perspectives
La modulation intraparcellaire en protection fongicide n’est pas davantage répandue. L’outil développé par BASF, Xarvio Field Manager, permet d’adapter la quantité de produit sur la base d’une carte de la biomasse, avec un modèle de prévision des stades de développement de la plante en fonction des dates de semis, de la variété, des données météorologiques... Résultat : moduler la pulvérisation à l’échelle de la rampe, de la buse ou du tronçon s’avère possible, selon le matériel dont l’agriculteur dispose. Celui-ci choisit la substance, la dose maximale qu’il veut appliquer et la machine adapte automatiquement selon la zone dans laquelle elle se situe.
« Les économies peuvent atteindre 15 % », prétend Jérôme Clair, responsable Xarvio Digital Farming Solutions. Ici, l’objectif est bien de réduire la quantité de produit. Cependant, les agriculteurs sont encore réticents. « Ils ont peur du risque encouru en réduisant la dose, constate Aymeric Lepage, de la chambre d’agriculture de l’Aisne. Le potentiel de développement de la technique est limité dans un futur proche. »

De nombreux freins à lever
Le développement de la modulation intraparcellaire, de façon générale, se heurte à son coût élevé. Mais « depuis deux ans, avec l’augmentation du prix de l’ammonitrate, les ventes d’outils équipés de la modulation de dose sont en plein essor », constate David Guy. Autre frein : l’aspect technique. « Aujourd’hui, dans un cas sur deux, personne ne s’inscrit pour suivre la formation à l’utilisation des machines, regrette François-Xavier Janin, chef de produit grandes cultures pour France Pulvé. Il faut réussir à démocratiser ces nouvelles technologies. »
Les constructeurs de matériels semblent unanimes : tout ça est trop compliqué. « Les exploitants ont peur de l’électronique », constate Florent Hendrycks, d’Amazone. Et puis, « quand on ne fait pas soi-même la carte de modulation, on n’est pas maître de son système, d’où certaines réticences », signale, Jean-Charles Lescieux. Au passage, il s’interroge sur la fiabilité des services clés en main proposés par certaines coopératives. Les constructeurs ont, en tout cas, bien conscience de la nécessité de simplifier l’accès aux technologies. Onze d’entre eux ont d’ailleurs créé un outil universel de transfert de données, baptisé Agri-Router. Le logiciel permet d’interconnecter les solutions, du bureau vers le champ et vice-versa.